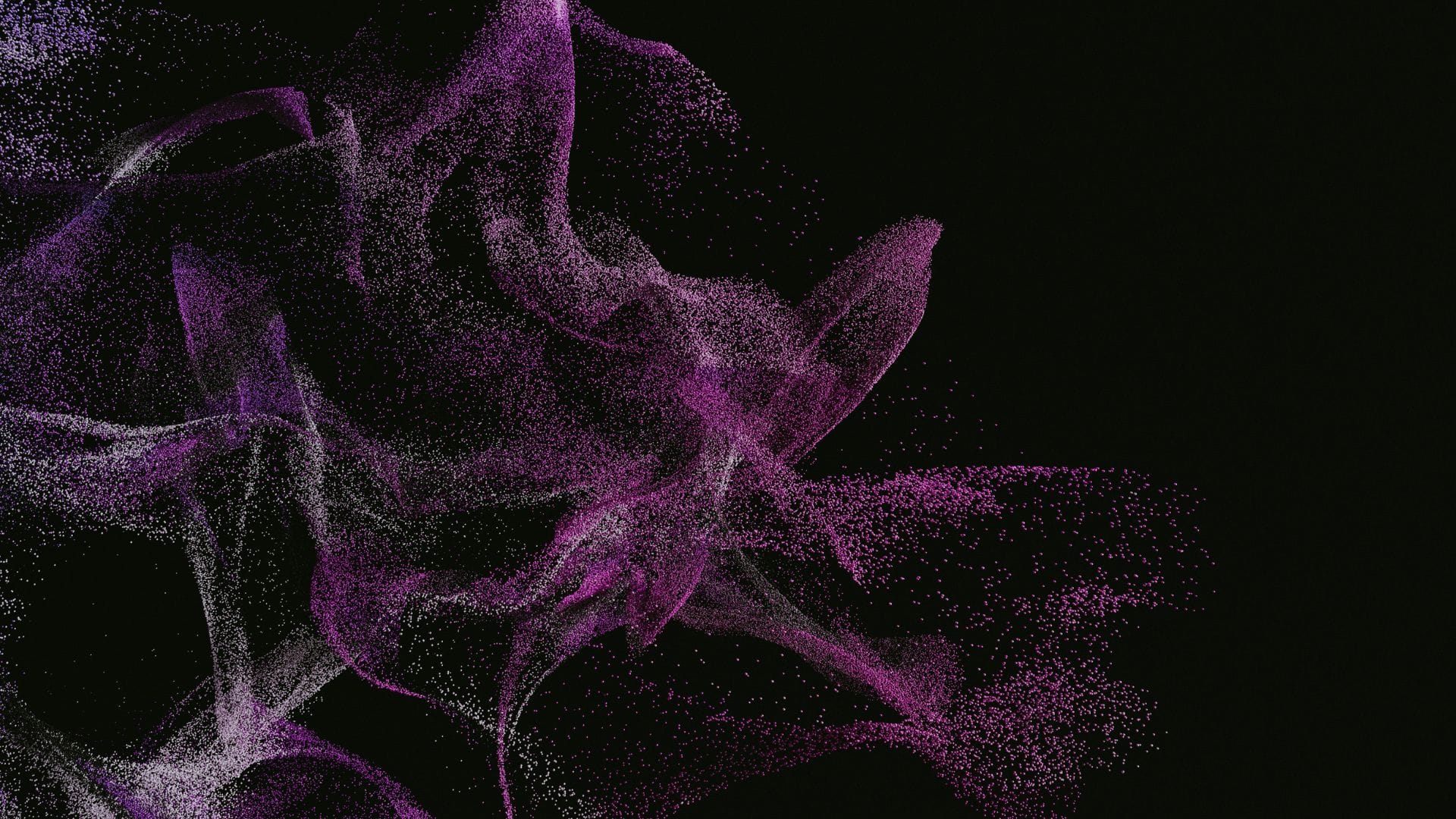
Repenser le financement de l’innovation: le transfert technologique comme levier stratégique
Publié le 12 juin 2025 access_time 5 minutesCet article est présenté par le Centre de développement et de recherche en intelligence numérique.

L’industrie de productions d’expériences numériques avance avec effervescence, mais fait face à des défis importants, dont le financement demeure l’un des plus pressants. À cela s’ajoute l’exigence de l’innovation en continu qui se heurte à la réalité des ressources limitées, obligeant les producteurs et productrices à envisager de nouvelles solutions. Comment, dès lors, imaginer de nouveaux modèles pour financer l’innovation?
Une piste souvent négligée mérite pourtant qu’on s’y attarde: le transfert technologique. Ce passage de relais entre recherche et industrie ouvre la voie à une meilleure optimisation des ressources, à une mutualisation des efforts et au soutien d’une innovation plus durable. Plutôt que de voir la R&D comme un simple coût, il s’agit de repenser les contraintes en levier concret pour transformer les idées en projets viables.
L’expérience du CDRIN en tant qu’acteur clé de la recherche appliquée en créativité numérique nous amène à croire que l’intégration de la R&D dans un modèle de financement structuré est essentielle.
Le transfert technologique permet aux entreprises d’accéder à des outils et à des expertises facilitant le passage de la recherche à l’application concrète, en plaçant la connaissance scientifique au cœur de la transformation des industries créatives.
Cet article propose d’examiner ces stratégies, en insistant sur l’importance de renforcer les liens entre recherche et industrie pour répondre aux défis actuels et bâtir une innovation plus résiliente.
Table des matières
- Le transfert technologique, levier de financement et d’innovation
- L’accompagnement stratégique: structurer l’innovation plutôt que réinventer
- Se préparer à l’avenir: vers une innovation durable, inclusive et responsable
- La collaboration comme levier de transformation du financement
- Penser en réseau, financer collectivement

Au Québec, le financement des producteur.rice.s d’expériences numériques progresse, mais les obstacles demeurent. Malgré l’arrivée du programme de la SODEC en 2023 — 7,5 millions de dollars pour 17 entreprises en 2024 —, le secteur reste à la traîne en comparaison avec d’autres secteurs des industries créatives. Ce financement parfois insuffisant peut limiter le développement de ces secteurs et freiner leur plein potentiel d’innovation.
Les producteur.rice.s doivent souvent naviguer entre des critères de financement strictes et une forte concurrence, ce qui peut compliquer l’accès aux ressources nécessaires pour réaliser des projets ambitieux. De plus, bien que certains programmes existent, le soutien à la commercialisation et à l’exportation demeure modeste dans plusieurs cas, ce qui peut restreindre la portée internationale des productions d’expériences numériques et freiner certaines avenues de croissance.
Face à ces enjeux, le transfert technologique et l’accompagnement en R&D s’imposent comme des leviers à explorer. En rapprochant recherche et industrie, ces mécanismes permettent aux producteur.rice.s d’accéder à des outils innovants et à des modèles économiques adaptés.
En évoluant en ce sens, le Québec pourrait consolider sa place en créativité numérique et favoriser l’innovation à plus grande échelle.
Le transfert technologique, levier de financement et d’innovation
Il faut voir le transfert technologique comme le trait d’union entre la recherche et le marché. C’est un mécanisme discret, mais essentiel, qui permet de faire passer la recherche fondamentale de la théorie à l’usage, en solutions concrètes ou commercialisables, tout en ouvrant de nouvelles voies de financement pour l’innovation. Ce processus s’appuie sur la gestion de la propriété intellectuelle, la création de partenariats, et l’accès à des fonds ciblés pour les phases critiques du développement. C’est une démarche de maillage entre chercheur.euse.s, entreprises et institutions publiques, qui permet à l’innovation de prendre racine dans des réalités concrètes.
Ainsi, quand la recherche et l’industrie travaillent main dans la main, les technologies émergent en réponse directe aux besoins du terrain. Au Québec, les 59 Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) , dont fait partie le CDRIN, incarnent cette interface de terrain. Leur ancrage régional et leur expertise appliquée facilitent l’intégration de technologies, notamment dans des domaines émergents comme les technologies immersives ou l’intelligence artificielle.
Parmi les modèles éprouvés, le programme Mon succès numérique (MSN)1 lancé en 2023 se distingue. Géré par les CCTT, il a soutenu 526 entreprises et permis la réalisation de 709 projets en transformation numérique. Le programme a généré des retombées supérieures aux attentes grâce à une gestion de proximité et à une entente claire avec le gouvernement, démontrant l’importance de ce maillon souvent méconnu dans la chaîne de l’innovation. Dans le contexte de cette initiative, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie dans le cadre de l’Offensive de transformation numérique a investi 11,6 millions, auxquels se sont ajoutés 5,2 millions en investissements privés.
Étude de cas — Motion Matching et IA pour la danse en VR
Contexte: Dans le cadre de ce programme, le studio montréalais Normal Studio et l’entreprise Nordra ont collaboré avec le CDRIN pour développer une solution de capture de mouvement en réalité virtuelle sans marqueurs optiques. Le projet, intégré à la production immersive Future Rites, utilise une combinaison de motion matching et de prédiction d’orientation par intelligence artificielle pour synchroniser en temps réel les gestes des participant.e.s avec ceux de danseur.euse.s professionnel.le.s.
Le défi: Adapter cette technologie à Unreal Engine 5, tout en assurant la fluidité, la précision et la compatibilité artistique du projet. Le CDRIN a accompagné l’ensemble du processus de recherche, l’évaluation, l’implémentation et l’optimisation, démontrant le rôle stratégique des centres dans le développement de technologies immersives.
«Dans le contexte actuel, surtout quand on parle de médias émergents, de technologies immersives ou d’intelligence artificielle, on se sent un peu à la merci de pratiques qu’on nous annonce comme étant celles de demain. Je trouve que d’avoir des organisations comme le CDRIN permet aux créateur.rice.s et aux autres institutions culturelles d’avoir leur mot à dire dans ce que vont devenir nos technologies de demain. »- Sandra Rodriguez , artiste numérique XR-IA, chercheuse et conférencière (citation tirée de la série vidéo Récits d’innovation du CDRIN)
Le mécanisme de transfert technologique dépasse le simple partage de savoir-faire: il facilite l’accès à des financements adaptés aux étapes charnières, comme le prototypage ou la validation commerciale.
Des programmes comme la subvention en recherche appliquée (RDA) ou encore Intelligence artificielle (Partenair-IA), géré par Prompt, soutiennent ce types d’initiatives recherche-industrie. Ils permettent de valider les concepts, d’optimiser les ressources et de limiter les risques pour les entreprises partenaires.
Le transfert technologique transforme concrètement les connaissances scientifiques en levier économique. Il raccourcit les délais entre prototype et marché, augmente les revenus issus de la commercialisation et contribue à la création d’emplois qualifiés. C’est une réponse directe aux enjeux de financement pour des secteurs comme l’industrie d’expériences numériques.
Quand un.e chercheur.euse, une PME et un CCTT se retrouvent autour de la même table, c’est l’ensemble de l’écosystème qui s’aligne. On investit dans ce qui fonctionne déjà. C’est pragmatique, mesurable et la démarche permet d’optimiser chaque dollar investi.
En repensant le financement autour de ce modèle collaboratif, il devient possible de bâtir un environnement propice à une innovation durable et compétitive.
L’accompagnement stratégique: structurer l’innovation plutôt que réinventer2
Dans l’écosystème de l’innovation, l’accompagnement stratégique joue un rôle clé. C’est un processus souple, mais structuré, qui aide les entreprises à prendre des décisions éclairées face à l’incertitude technologique. Plutôt que de tout réinventer, il s’agit ici d’écouter, d’observer et de construire à partir de l’existant — une logique de co-création où la collaboration prime sur la rupture.
Cet accompagnement, tel que le proposent les Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) du Réseau des CCTTT-Synchronex, repose sur une approche par phases: analyse des besoins, veille technologique, preuve de concept, prototypage, validation, implémentation. Chaque étape est pensée pour réduire les risques, optimiser les ressources et s’aligner sur les priorités réelles des entreprises. Pour les producteur.rice.s d’expériences numériques, souvent confrontés à des enjeux de rapidité et de financement, cet appui devient stratégique.
Le CDRIN, spécialisé en intelligence numérique, agit comme point de contact concret entre l’idée et son application. Grâce à des expertises ciblées, il accompagne les entreprises dans le développement de prototypes, l’expérimentation en contexte réel et la validation technologique. Ce type de soutien s’inscrit dans une dynamique d’innovation partagée, où recherche et industrie évoluent dans une relation bidirectionnelle.
Étude de cas — Simplifier le voyage de la 2D à la 3D (E.D.Films)
Contexte: Dans le cadre de sa collaboration avec E.D. Films, le CDRIN a entrepris de simplifier le passage de la création 2D à la modélisation 3D. Le point de départ: un processus dans Maya encore largement manuel, reposant sur l’exportation de calques dans Photoshop. Les outils existants produisent des modèles triangulés, peu adaptés à l’animation.
Le défi : Comment automatiser ce processus sans sacrifier la qualité artistique ni la précision technique? L’équipe a misé sur le développement d’un plugin Maya capable de lire directement les calques d’un fichier Photoshop, d’en extraire textures et contours, et de générer un modèle structuré autour de quads, optimisé pour l’animation. L’outil conserve le lien avec le fichier source, permettant un travail itératif et fluide, tout en offrant aux artistes la possibilité d’influencer la forme du modèle via des calques dédiés.

À cette échelle, l’innovation ne repose pas uniquement sur l’accès aux fonds. Elle dépend d’un écosystème structuré. Les CCTT offrent aussi un appui pour naviguer dans l’univers des subventions et incitatifs comme le Programme de soutien à l’innovation (PSO) du MEIE ou les crédits d’impôt à la R-D. D’autres organisations comme Axelys contribuent à encadrer le transfert de propriété intellectuelle, notamment dans des contextes de valorisation technologique.
En conjuguant expertise technique, équipements spécialisés et connaissance fine des programmes de financement, ces centres facilitent l’ancrage des projets dans le réel. Ils aident à transformer une intention innovante en feuille de route concrète, économiquement viable. L’impact est direct: des cycles de développement plus courts, des investissements mieux utilisés et une capacité accrue à se démarquer sur les marchés.
C’est dans cette approche collaborative et structurante que se joue, aujourd’hui, une partie de l’avenir de l’innovation de productions d’expériences numériques dans une perspective durable. Non pas dans une rupture radicale, mais dans la mise en commun d’intelligences diverses, connectées au terrain.
Se préparer à l’avenir: vers une innovation durable, inclusive et responsable
Face aux défis éthiques, écologiques et sociaux, l’industrie des expériences numériques est appelée à adopter une approche d’innovation qui tient compte de son impact à long terme. Cela signifie repenser les pratiques dès la conception: intégrer des critères d’accessibilité pour tous les publics, limiter l’impact environnemental des technologies utilisées et garantir un usage éthique et transparent des données. Une telle démarche constitue désormais un fondement essentiel de toute innovation durable.
La recherche appliquée joue ici un rôle central. Elle permet d’explorer de nouvelles méthodes, de tester des matériaux ou des processus moins énergivores, de concevoir des interfaces inclusives dès les premières phases. Dans ce contexte, les technologies numériques deviennent non seulement des outils de création ou de divertissement, mais aussi des vecteurs de transformation sociétale.
Plusieurs centres au Québec adoptent déjà une approche similaire, en intégrant des principes de co-développement avec les communautés concernées. Par exemple, l’Escouade Énergie, regroupant plusieurs CCTT, expérimente une approche concertée pour répondre aux défis de transition énergétique. L’Escouade numérique, dont le CDRIN fait partie, est une autre initiative du Réseau des CCTT. Celle-ci mise sur le développement collaboratif entre chercheurs, praticiens et communautés. Des centres comme le LLio (Laboratoire en innovation ouverte) ou le Crispech intègrent quant à eux des pratiques sociales novatrices, en plaçant les besoins des usagers au cœur du processus d’innovation.
L’intelligence artificielle et les données, utilisées de manière stratégique, permettent quant à elles d’optimiser les ressources, de mieux cibler les publics et de personnaliser les expériences, tout en soulevant de nouvelles responsabilités quant à leur utilisation.
Sur le plan du financement, quelques stratégies concrètes peuvent faire la différence. Diversifier ses sources, structurer un portefeuille de projets hybride (entre livrables à court terme et ambitions à plus long terme), et dialoguer activement avec les financeurs en sont quelques-unes. Mettre en avant l’impact structurant d’un projet — sur un territoire, une chaîne de valeur ou une pratique culturelle — augmente sa crédibilité et son potentiel de soutien. Il ne s’agit pas seulement de produire, mais de contribuer à une vision partagée, alignée avec des objectifs collectifs.

La collaboration comme levier de transformation du financement
Répondre aux besoins des industries créatives ne passera pas uniquement par l’augmentation des budgets, croyons-nous, mais par une transformation des modèles de financement eux-mêmes. Plus flexibles, plus collaboratifs, plus connectés à la réalité du terrain.
Un modèle inspirant existe déjà: celui de Mon succès numérique (MSN) dont on a parlé plus haut, qui a permis de canaliser les fonds publics vers un projet collectif structurant, géré de manière agile par un acteur reconnu du milieu. Ce modèle peut servir de point de départ pour créer un fonds dédié à l’innovation des productions d’expériences numériques avec des règles claires, des indicateurs communs et une gestion en amont. Le gouvernement, plutôt que d’évaluer une à une des dizaines de demandes disparates, soutient une initiative d’ensemble, pensée dès le départ pour avoir un impact mesurable.
Le rayonnement de cette expertise dépasse déjà les frontières du Québec. Un membre de Xn Québec a contribué à la conception du Pavillon du Canada à l’Expo Osaka 2025, un espace immersif qui conjugue narration sensible, innovation technologique et portée internationale. Ce projet, audacieux et collaboratif, incarne l’esprit même d’un modèle structurant: mutualiser les talents pour créer des expériences porteuses, pensées dès l’amont pour inspirer et rassembler.
Cette approche permet de soutenir la co-création, des projets collectifs ambitieux, d’intégrer des phases d’expérimentation dans les projets financés, et de réduire les risques associés aux premières étapes du développement. Il permettrait de reconnaître les efforts en interopérabilité, durabilité et transformation des processus de production. Surtout, elle repose sur une vision commune et des indicateurs d’impacts clairs, ce qui la rend lisible pour les bailleurs de fonds et mobilisatrice pour l’écosystème.
Les centres de recherche appliquée — comme le CDRIN — sont des partenaires clés dans cette logique. En offrant accès à des expertises pointues, des équipements spécialisés et une connaissance fine du terrain, ils permettent aux entreprises d’innover sans supporter seules les coûts de développement. Des programmes hybrides, combinant subventions publiques et investissements privés, montrent qu’une approche en réseau maximise les retombées économiques tout en soutenant l’expérimentation.
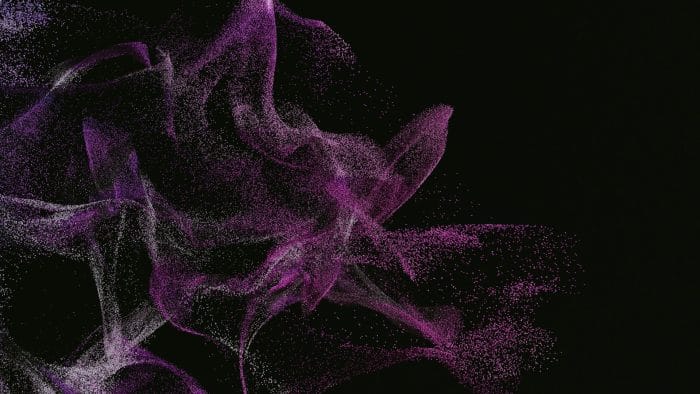
Penser en réseau, financer collectivement
En repensant le financement comme un outil de cohésion sectorielle plutôt que comme un guichet à projets, le Québec peut faire de l’industrie de producteurs d’expériences numériques un champ d’innovation durable, inclusif et économiquement viable. Il ne s’agit pas seulement de soutenir l’émergence de technologies, mais de bâtir un écosystème où recherche, production et politiques publiques avancent ensemble, avec des objectifs partagés.
Le moment est propice: les outils existent, les compétences sont là, et plusieurs exemples montrent que ce qui fonctionne localement peut structurer un modèle global. Reste à le reconnaître, à l’organiser et à l’amplifier.
1 Le programme est terminé et en évaluation de reconduction.
2 https://reseaucctt.ca/actualites/transfert-technologie-accompagnement




